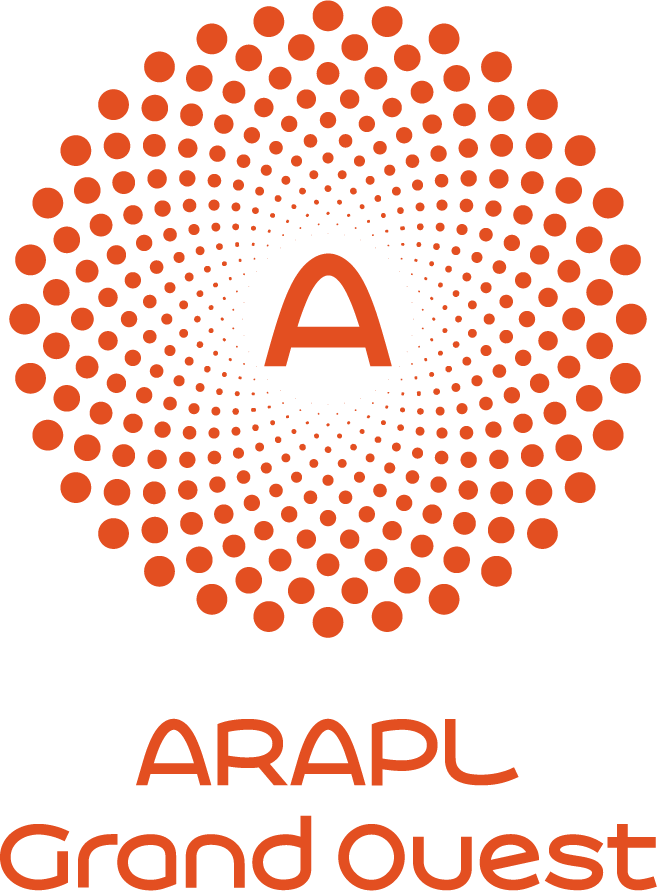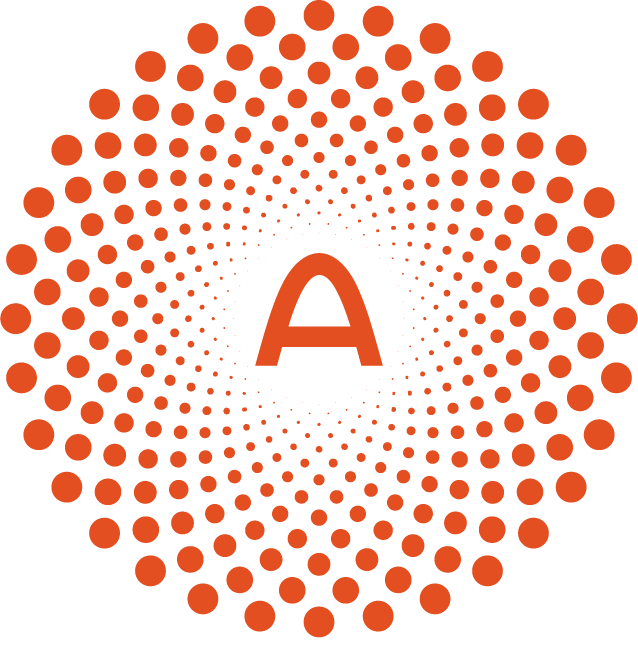Qu’est-ce que le seuil de rentabilité ?
Notion purement comptable, le seuil de rentabilité est le montant du chiffre d’affaires à atteindre pour que le résultat de l’entreprise soit à l’équilibre, c’est-à-dire lorsque le total des recettes couvre le total des charges.
C’est donc à partir du moment où le seuil de rentabilité est dépassé que l’entreprise dégage un bénéfice, on dit alors que l’activité est bénéficiaire. Dans le cas contraire, l’activité est déficitaire.
Le seuil de rentabilité permet de se fixer des objectifs de développement et des actions d’évolution sur le long terme.
A quoi sert le seuil de rentabilité ?
Calculé au moment de la création d’une entreprise, il permet de s’assurer de la viabilité du projet et de construire business plan et prévisonnel.
Si par exemple, un emprunt bancaire est sollicité, le seuil de rentabilité estimé sur plusieurs années permettra à la banque d’apprécier la faisabilité de l’opération.
Ultérieurement, le seuil de rentabilité va être déterminé à chaque modification importante de l’activité libérale : réalisation d’un investissement onéreux, embauche d’un salarié, ou encore modification des prestations proposées. Il permet ainsi de garder le cap et d’éviter certaines erreurs de gestion.
Différence avec le “point mort”
Le seuil de rentabilité et le point mort sont basés sur le même type de ratio permettant de déterminer quand l’activité sera profitable. Toutefois, le seuil de rentabilité s’exprime en chiffre d’affaires, alors que le point mort s’exprime en temps.
Le point mort permet de déterminer le nombre de jours nécessaires pour que l’activité devienne bénéficiaire.
Comment le déterminer dans une entreprise libérale ?
Contrairement aux activités commerciales, le calcul du seuil de rentabilité des entreprises libérales est relativement simple.
N’ayant pas de charges variables (sauf rares exceptions), l’entreprise libérale est rentable à partir du moment où ses recettes atteignent celui de ses charges fixes.
Seuil de rentabilité : recettes HT = charges fixes HT
Les charges fixes
Les charges fixes sont les frais qui se rapportent à votre activité et dont le montant ne varie pas en fonction du montant de vos recettes :
- loyer du cabinet
- frais de fonctionnement (électricité, téléphone, internet, licence de logiciel professionnel, frais bancaires…)
- amortissement des immobilisations
- honoraires récurrents à payer (expert-comptable par exemple, cotisation à l’Ordre professionnel)
- salaires du personnel
Le point mort
Dans les entreprises libérales, on facture généralement un taux horaire ou journalier. Le point mort se calcule alors de la manière suivante :
Point mort = Charges fixes / Taux horaire (ou taux journalier)
Exemple : Un consultant a un taux horaire de 80 € et 25 600 € de charges fixes.
Nombre d’heure à facturer = 25 600 / 80 = 320 heures
A partir de la 321e heure facturée, l’entreprise dégage un bénéfice.